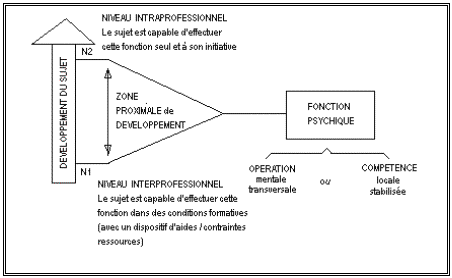
1- Dans le monde du travail
Ce sont des compétences qui ne sont ni spécifiques, ni techniques, elles sont générales et peuvent être utilisées dans plusieurs fonctions. Elles relèvent du domaine social et relationnel (animation, travail en groupe, adaptation et changement, innovation, communication, créativité, prise de décisions...).
2- A l'école
Ph. Meirieu parle de capacités méthodologiques transdisciplinaires qui permettent de discerner et de mettre en oeuvre les opérations mentales requises selon les procédures personnelles identifiées comme les plus efficaces.
Le document sur les cycles à l'école primaire distingue trois types de compétences:
- des compétences transversales ;
- des compétences d'ordre disciplinaire (savoirs et méthodes spécifiques) ;
- des compétences dans le domaine de la maîtrise de la langue.
Les compétences transversales sont relatives:
- aux attitudes de l'enfant (personnalité, autonomie...) ;
- à la construction des concepts fondamentaux d'espace et temps ;
- aux acquisitions méthodologiques (mémoire, méthodes de travail, traitement de l'information).
Les méthodes de travail concernent:
- l'attention, l'observation, la concentration, l'effort, le soin ;
- la participation à un projet ;
- l'application de consignes ;
- l'organisation du travail personnel
- la gestion du temps ;
- la présentation du travail.
2-1 L'école et les compétences transversales
Constat très empirique : les élèves pensent rarement à utiliser dans une matière ce qu'ils ont appris dans une autre.
Pour Ph.Perrenoud les connaissances procédurales ou méthodologiques peuvent rester lettre morte si le sujet n'est pas capable de les mobiliser en situation. L'Ecole croit traiter de savoirs purs, décontextualisés ; ces savoirs sont, en réalité, étroitement contextualisés mais on ne s'en rend pas compte. On se trouve régulièrement étonné lorsque les élèves placés, par accident, dans de nouveaux contextes semblent ne rien avoir appris. Ils ont appris en contexte et incorporé le contexte au savoir faute d'activités de décontextualisation, de transposition,d'étayage, de désétayage.
A quoi servirait la capacité de discourir sur la bonne façon de s'y prendre, si on ne sait pas la mettre en oeuvre, de façon régulière et spontanée, hors d'une situation d'exercice scolaire, face à de vraies incertitudes pour prendre de véritables décisions ?
J.Tardif constate que les élèves disposent d'un nombre très limité de ressources cognitives quand ils sont " en panne". Ils n'ont pas développé de stratégies efficaces qui garantiraient qu'ils puissent savoir quoi faire lorsqu'ilé ne savent plus quoi faire.
L'Ecole conduit les élèves à ne pas savoir ce qu'ils savent et, pire encore, à ne pas savoir ce qu'ils ne savent pas ; sans aucun doute parce que les enseignants n'interviennent pas assez sur le développement de la métacognition.
Les élèves estiment que de nombreux apprentissages réalisés à l'école ont peu de signification. L'Ecole est perçue davantage comme un endroit ou l'on est évalué que comme un endroit ou l'on apprend.
Pour Ph.Meirieu, beaucoup d'élèves maîtrisent les savoirs déclaratifs, ils savent réciter un théorème ou une règle (par exemple, la règle d'accord du participe passé) mais ils ne savent pas transposer ces savoirs déclaratifs en savoirs procéduraux. Ils ne sont pas capables d'identifier la famille à laquelle appartient le problème ni d'identifier les outils qui permettraient de le traiter alors qu'il faudrait :
1- identifier le problème ;
2- maîtriser les outils ;
3- corréler le problème avec les bons outils, or il ne suffit pas de savoir maîtriser les outils pour savoir les utiliser correctement dans toutes les situations.
2-2 Mais y-a-t-il des compétences méthodologiques ou transversales ?
Bernard Rey (les compétences transversales en question E.S.F, 1996) en doute. Les recherches, dit-il, montrent qu'un élève "expert" n'est pas celui qui sait mobiliser des capacités transversales dans un grand nombre de situations nouvelles mais plutôt celui qui connaît un grand nombre de situations particulières. Celui qui se trompe le fait souvent parce qu'il généralise trop les capacités dont il dispose. Il fait, en quelque sorte, usage de fausses compétences transversales.
Les compétences ou les capacités ne s'appliquent qu'au domaine au sein duquel elles ont été apprises. B.Rey propose de remplacer la notion de "compétence transversale" par celle d"'intention transversale" qui caractérise le sujet capable de repérer dans une situation nouvelle quelle compétence il doit mettre en oeuvre.
Ph.Meirieu considère qu'il y a, sur cette question, deux courants qui s'opposent :
a). Il y a ceux qui pensent que l'on peut acquérir des habiletés cognitives qui sont relativement déconnectées des matériaux sur lesquels on travaille et qui se stabiliseront en capacités générales. Meirieu donne comme exemple le Programme d'Enrichissement Instrumental de Feuerstein qui prétend faire acquérir, en particulier par des populations en difficulté, des processus généraux de pensée indépendamment de l'apprentissage de contenus spécifiques.
b). Il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas de capacités transférables d'une discipline à l'autre. Les capacités a-disciplinaires transversales n'existent pas, il n'y a que des savoir-faire locaux trés spécifiquement incarnés dans des disciplines. Ce n'est pas, par exemple, parce qu'un élève sait argumenter en mathématique qu'il saura argumenter dans d'autres domaines.
Meirieu propose d'adopter, sur cette question, la position suivante :
a). Il y a un effet positif lorsque , dans une classe, on ne s'intéresse pas seulement aux connaissances mais aussi aux métaconnaissances.
b). Il n'est pas sûr qu'une capacité générale puisse être transférée facilement d'un domaine à l'autre ; il faut éviter des transferts trop hâtifs et essayer plutôt de faire acquérir, au sein de chaque discipline, des méthodologies qui pourront être regroupées et permettront la construction de capacités générales.
c). Les capacités générales peuvent fonctionner plutôt comme des outils de mise en cohérence des enseignements disciplinaires.
d). Les capacités a-disciplinaires n'existent sans doute pas mais il est préférable de faire comme si elles existaient en les prenant en compte dans toutes les disciplines ( l'argumentation, par exemple).
3-Compétences de haut niveau et transferts
C'est, sans aucun doute, la réflexion sur la construction de véritables compétences de haut niveau qui peut nous permettre de dépasser ces contradictions.
Pour Ph. Perrenoud ces compétences s'appuient sur des savoirs étendus et explicites et restent pertinentes pour une très large classe de problèmes car elles incluent des possibilités d'abstraction, de généralisation et de transfert. L'individu compétent sait donc utiliser ses compétences dans des situations nouvelles. Mais, bien entendu, cette conception implique de profonds changements dans les pratiques pédagogiques.
Pour J.Tardif:
1- Les enseignants et les élèves sont trop centrés sur les produits au détriment des processus. Il faut rendre plus explicites les démarches et les stratégies mises en oeuvre.
2- Les activités sont trop souvent morcelées et ne contiennent pas de défis cognitifs susceptibles de mobiliser les compétences en les enrichissant.
3- La majorité des connaissances se construisent sans interactions entre pairs, les élèves sont donc privés des occasions qui leur permettraient, en groupe de coopération, de discuter de leurs connaissances pour leur octroyer un certain degré de certitude, de les confronter pour découvrir le champ de validité et de les utiliser pour en déterminer le degré d'efficacité et de transférabilité.
Meirieu se réfère à VYGOTSKY qui considère, à la différence de Piaget, que les apprentissages précèdent le développement à condition de fournir à l'apprenant les aides requises au moment où il se trouve dans la zone optimale de développement.
Il faut donc mettre en place :
- dans un premier temps, un dispositif d'étayage aussi bien sur le plat socio-relationnel que sur le plan cognitif ;
- dans un second temps, des situations de désétayage qui permettront à l'apprenant d'acquérir des connaissances tout en devenant indépendant dans l'usage qu'il en fera.
Il est en effet fondamental de permettre à l'élève de se dégager progressivement de cette aide afin d'éviter la dépendance vis-à-vis de la situation d'apprentissage et vis-à-vis de 1'enseignant.
( Voir schéma 1).
La décontextualisation joue un rôle fondamental dans la transformation des connaissances en compétences. Il faut proposer et faire rechercher par les élèves d'autres situations dans lesquelles ils pourront faire jouer, mobiliser ce qu'il auront appris.
Les élèves exercent une véritable compétence lorsqu'ils analysent le problème rencontré en ne s'en tenant pas aux indicateurs de surface le contexte conjoncturel, la nature des premiers exemples rencontrés (exemple: l'âge du capitaine) mais en recherchant les indicateurs de structure qui caractérisent véritablement le problème.
Cette orientation permet de dépasser le débat sur les méthodes transversales ;elle s'inscrit dans un ensemble de procédures de métacognition qui facilitent transfert ou décontextualisation et autonomie.
3) Autres mots
finalités, objectifs, savoir, savoir-faire, savoir-être, compétence, capacité, métacognition, interaction
4) Sources
Le petit dictionnaire de la formation (E.S.F.)
Philippe Meirieu « Apprendre oui mais comment » (E.S.F.)
Eduquer et Former (Sciences Humaines)
Les cycles à l'école primaire (C.N.D.P. Hachette)
Philippe Meirieu « le statut de l'erreur » (Revue Communiquer) (C.D.D.P. Var)
Ph.Perrenoud, J.Tardi (Savoirs et savoir-faire) (entretiens Nathan)
Dictionnnaire Education Formation (Nathan)
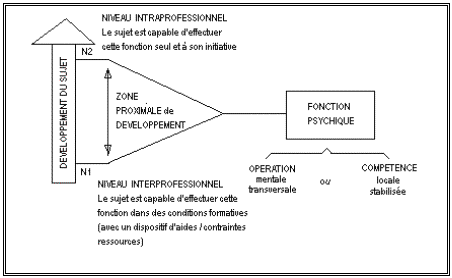 |
Schéma 1
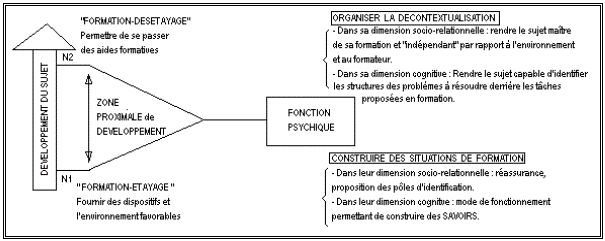 |
Schéma 2